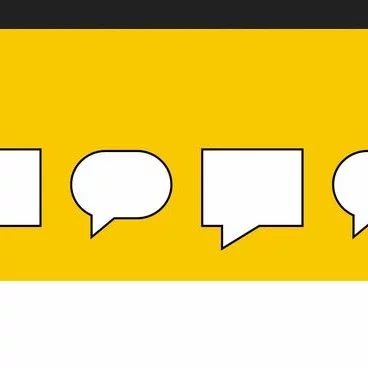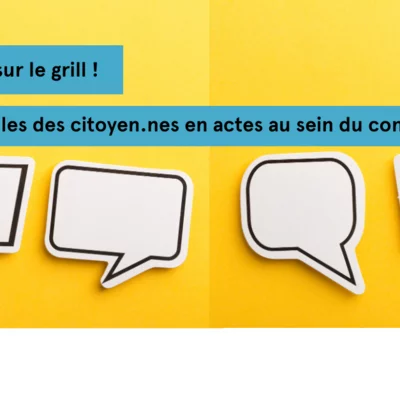Pour les citoyens des quartiers populaires, la démocratie peut-elle encore passer par le bulletin de vote ?
Le 14 janvier dernier, le Réseau national des centres de ressources politique de la ville (RNCRPV) a organisé un premier webinaire sur la question du vote des habitants en quartier politique de la ville. Dans cet article, nous vous proposons un résumé succinct des interventions et surtout, l'accès vers le visionnage du webinaire.
Contexte
Ce webinaire s'inscrit dans un cycle intitulé « La participation sur le gril ! », proposé par le Groupe de travail « Démocratie et quartiers populaires » du Réseau national des centres de ressources politique de la ville pour inviter à réfléchir aux conditions nécessaires pour que les citoyens des quartiers populaires soient pleinement associés à l’élaboration, la construction et la mise en place des politiques publiques qui les concernent et qui impactent leurs vies, à travers des modalités de participation protéiformes, évolutives et ascendantes.
Ce webinaire a abordé la question de l’abstention dans les quartiers populaires, devenue un phénomène structurel qui atteint des niveaux records, y compris lors des élections locales. Cette abstention est souvent considérée, notamment sur le plan médiatique, comme la preuve de l’apathie politique des citoyens et citoyennes des quartiers populaires et de leur désintérêt pour les affaires publiques. Pour autant, les élections législatives anticipées de l’été 2024 ont démontré que ces citoyens et citoyennes savent retrouver le chemin des urnes lorsqu’ils considèrent que le vote est habité de véritables enjeux. Par ailleurs, conclure à l’apathie politique à partir de l’abstention, alors que près d’un quart des habitants et habitantes de ces quartiers n’ont pas le droit de vote, revient à nier leur engagement dans de nombreuses initiatives citoyennes.
Intervenants
- 6'50 : David GOUARD, Maître de conférences en science politique - Université Toulouse Jean Jaurès
- 41'58 : Daniel GAXI, Professeur émérite à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
- 1h15'20 : Ilham GREFI et Dawari HORSFALL pour l’Assemblée des quartiers
Résumé
1. Evolutions sociohistoriques et logiques contemporaines de la participation électorale dans les banlieues populaires (David GOUARD)
1. Quelle histoire peut-on faire de la participation électorale dans les quartiers populaires ?
En France, historiquement, c'est au début des années 1970 que l'on atteint un pic de participation électorale, notamment dans les villes populaires et plus précisément dans les quartiers les plus populaires de ces villes, dans lesquels le niveau de participation électorale était encore plus fort. Plusieurs facteurs d'explication sont à souligner : ces quartiers détenaient un écosystème très favorable à cette participation électorale élevée (il y régnait un fort sentiment d'appartenance sociale, qui correspondait qui plus est à une identité sociale valorisée (celle du milieu ouvrier mais aussi celle de la classe populaire)) ; il y avait un ancrage social fort des partis politiques de gauche dans ces quartiers ; les habitats collectifs étaient hautement valorisés par des habitants issus de milieux très défavorisés qui ont gagné en confort en accédant à ces logements ; le corps politique faisait aussi beaucoup plus partie du quotidien des habitants et se mobilisait en dehors des périodes de campagne électorale dans les événements quotidiens du quartier (fête, réunions, moments de convivialité...). La participation électorale durant ces années-là représentait donc la norme.
A la suite de cette période, la France connaît trois crises majeures :
- Crise du monde ouvrier : le monde industriel connaît un effondrement, avec la désindustrialisation, la tertiarisation de l'économie, la transformation des emplois, la désyndicalisation et des transformations socio-démographiques au sein des milieux populaires (immigrations de différentes populations) ;
- Crise de l'ancrage social des partis politiques : le nombre d'adhérents et de militants sont en déclin, avec le départ des jeunes militants hors du quartier, la transformation des partis (la "bureaucratisation" des partis et l'avènement des "partis d'élus" dans lesquels les élus prennent une place plus importante que les adhérents) ;
- Crise du modèle de sociabilité des quartiers populaires : les quartiers populaires sont de plus en plus stigmatisés socialement. Au sein même des villes populaires de gauche, on assiste à une fragmentation territoriale (avec d'un côté des espaces du centre ville réhabilité et assez valorisé socialement et de l'autre, de zones plus périphériques délaissées et stigmatisées).
Ces crises sont venues fortement favoriser le mécanisme d'abstention électorale.
2. Quelles sont les logiques et les tendances contemporaines en matière de participation électorale ?
Dans les quartiers populaires, l'abstention électorale peut s'expliquer par différents phénomènes :
- La mal inscription ;
- La non-inscription n'est pas prise en compte dans le mécanisme de l'abstention ou de la participation, mais il contribue de fait à l'augmentation mécanique du taux d'abstention ;
- La participation intermittente est un phénomène globalement observé : les électeurs qui s'abstiennent à toutes les élections sont peu nombreux.
Dans ces quartiers, l'élection présidentielle continue de susciter l'intérêt des électeurs, notamment en raison de son traitement médiatique.
Désormais, le choix du vote pour un parti politique s'explique moins par l'adhésion à un bloc politique que par l'opposition à d'autres partis.
Dans les quartiers populaires durant les années 1990, 2000 et début 2010, les partis de gauche (notamment le Parti socialiste) sont très soutenus (ils réalisent des scores supérieurs à ceux enregistrés au niveau national). Le vote à gauche des quartiers populaires est aujourd'hui toujours dominant, mais depuis quelques années, il y a beaucoup de villes populaires qui sont dirigées par une majorité de droite (ex : Roubaix, Tourcoing).
A l'occasion des dernières élections législatives de 2024, la participation électorale est fortement remontée dans ces quartiers, ce qui peut notamment s'expliquer par un sentiment d'urgence face à la crise politique actuelle et également par la simplification de l'offre politique proposée en trois blocs politiques.
2. L'abstention électorale : éléments d'analyse et suggestions de pistes pour tenter de la contenir (Daniel GAXI)
On peut expliquer la participation électorale à travers plusieurs facteurs (et donc inversement l'abstention), celle-ci dépend :
1. De dispositions électorales individuelles (âge, position sociale, niveau de diplôme...)
Sur une vingtaine d'années, on constate une légère tendance à l'augmentation de l'abstention systématique. En 2022, un tiers des Français votent aux quatre tours.
Selon le niveau de diplôme, le vote est plus systématique chez les personnes au niveau de diplôme élevé que les autres. De même, plus la position sociale est élevée, plus le vote est systématique aux élections. Le vote intermittent est aussi très lié à l'âge : le vote systématique augmente avec l'âge (jusqu'à 80 ans). Autrement dit, plus les personnes sont jeunes, plus le vote intermittent est présent. L'écart de participation selon l'âge varie aussi beaucoup selon le type d'élections.
Les dispositions électorales sont variables. Certains sont disposés à voter en toutes circonstances, d'autres sont tentés de s'abstenir :
- Les dispositions politiques : plus l'intérêt pour la politique est fort, plus les dispositions à voter sont présentes et la participation régulière. L'intérêt politique dépend essentiellement du niveau d'éducation.
- Les dispositions civiques ("le sentiment du devoir civique") : les enquêtes sociologiques montrent que les dispositions civiques sont relativement indépendantes des dispositions politiques (on peut avoir des dispositions civiques fortes sans pour autant avoir des dispositions politiques structurées).
2. De l'attractivité de l'élection
L'attractivité de l'élection dépend elle-même d'une multitude de facteurs : l'incertitude des résultats, les différences sensibles et visibles entre les candidats, les sujets sur lesquels se focalise la campagne électorale, la représentation des principales tendances politique, l'engouement en faveur d'un ou de plusieurs candidats, la notoriété des candidats.
Il y a aujourd'hui une perte d'attractivité générale des élections, notamment en raison d'un phénomène de défiance. Dans les milieux populaires, la défiance est fondée sur l'expérience sociale et personnelle de chacun. De plus, ce phénomène de perte d'attractivité des élections est à rapprocher de la dégradation de la situation socio-économique des catégories populaires (chômage, augmentation de la précarité, régression du pouvoir d'achat, difficultés à se loger).
Il existe une attractivité relative de l'élection présidentielle : il y a une réactivation des attentes politiques lors de la campagne électorale.
3. Du coût de la participation
L'abstention s'élève quand la participation devient plus couteuse (en temps, en effort, en sacrifice). Il existe différents facteurs qui contribuent à élever le coût de la participation :
- Des facteurs individuels, tels que des problèmes de santé (on estime que la moitié de l'augmentation de l'abstention constante résulte de l'accroissement du nombre de citoyens très âgés et qui ne peuvent plus se déplacer), des engagements concurrents professionnels, familiaux et sportifs, ou encore en raison de l'éloignement du bureau de vote (la mal-inscription est l'un des gros facteurs de l'abstention).
- Des facteurs collectifs, en fonction de si l'élection a lieu sur un jour férié ou ouvré, pendant ou hors vacances scolaires, en période de pandémie, en fonction aussi de l'intervalle entre plusieurs élections, ou encore de la complexité de l'inscription sur les listes.
Pour les plus intéressés par l'élection, l'élection est un bénéfice plus qu'un coût.
4. Des mobilisations des électeurs
- Les mobilisations inter individuelles (l'entourage, les leaders d'opinion, les contacts avec des militants de parti)
- Les mobilisations institutionnelles (l'incitation au vote par les pouvoirs publics, la campagne d'inscription, les informations sur les élections...)
- Les mobilisations partisanes : l'affaiblissement des partis politiques ces dernières années a conduit à un affaiblissement des moyens mis en œuvre pour la mobilisation.
- Les couvertures médiatiques
Quelques pistes pour contenir l'abstention ?
- La mise en place de politiques de la citoyenneté afin de réengager les personnes dans le processus de la citoyenneté en instaurant des rites de passage à la citoyenneté (cérémonies, éducation des jeunes...) ;
- La mobilisation des associations et mouvements citoyens pour lutter contre l'abstention : agir sur le phénomène de non-inscription ou de mal-inscription dans les bureaux de vote ;
- Campagnes de communication relatives aux élections pour faciliter le repérage ;
- Constituer des listes plus attractives pour rendre les élections plus attractives ;
- Réancrer socialement les partis politiques.
3. Comment mobiliser, représenter et faire entendre la voix des quartiers populaires dans les élections et dans l'espace démocratique ? (Ilham GREFI et Dawari HORSFALL)
L'Assemblée des quartiers est un mouvement collectif initié en 2023 puis lancé en 2024 à Montpellier (34). Il regroupe un ensemble de collectifs déjà existants (Forum social des quartiers populaires, Mouvement de l'immigration et des banlieues, Les Motivées / Tactikollectif, Emergence, Comité Adama, Réseau Pas sans Nous et le Front de Mères).
En 2010, le Mouvement Emergence qui réunit des professionnels du secteur associatif de quartiers populaires se présente aux élections régionales et fait un peu plus de 9% avec une liste de plus de 235 personnes.
Quelles sont les méthodologies d'actions de l'Assemblée des quartiers ?
- Rassembler les électeurs : afin d'allier différents quartiers qui partagent les mêmes valeurs et priorités.
- Porter l'autonomie politique des quartiers : en mettant en valeur les savoirs expérientiels, les savoir-faire et compétences des habitants des quartiers.
- Une organisation politique des quartiers : le mouvement souhaite aller au plus près des habitants et s'ancrer localement dans les quartiers pour leur permettre de s'investir politiquement. L'objectif est aussi d'outiller les habitants pour qu'ils puissent appréhender les élections dans les meilleures conditions.
- Prendre le pouvoir politique collectivement : instaurer une stratégie collective pour sortir les quartiers de la précarité sociale et démocratique.
Projet "Maire de ma ville" : mobiliser la jeunesse à travers la citoyenneté et l'art
Ce projet a été construit par des jeunes de Grigny (91), via l'association Grignywood. Il s'agit d'un tremplin musical durant lequel les jeunes candidats doivent écrire un texte sur ce qu'ils feraient s'ils étaient maires ; ce texte est chanté et le public vote pour le meilleur texte. Les jeunes s'inscrivent pour devenir candidat. Il s'agit d'un concours, les gagnants remportent un prix.
L'objectif de ce projet est de mobiliser les jeunes autour des questions citoyennes.
Ce parcours dispose de 4 étapes :
- Lancement et mobilisation (castings et sensibilisation via les réseaux sociaux) ;
- Ateliers d'écriture (accompagnement par des professionnels pour structurer les créations) ;
- Pré-sélections (mise en avant des productions sur une plateforme numérique) ;
- Restitution finale (événement public pour valoriser les participants).
L'Assemblée des Quartiers, avec l'association Humanitaria a pour projet de relancer ce projet à l'échelle nationale.
Contact PQN-A
Vous souhaitez nous contacter à propos de cette ressource ?
Contactez Charlie Delorme, chargée de mission politique de la ville et participation citoyenne / Tél : 07 57 00 54 59