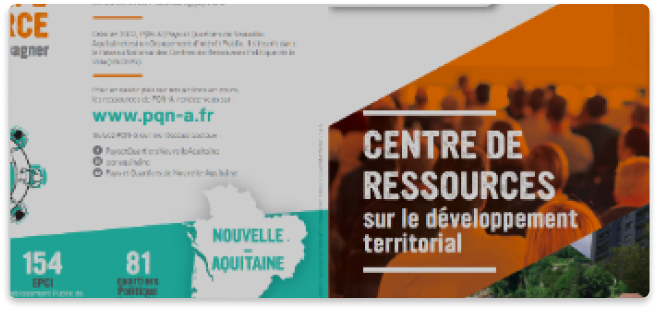La création du FPH date des Comités interministériels des villes (CIV) des 30 juin et 2 décembre 1998, à la suite desquels le ministère délégué à la Ville, Claude Bartolone, mettait en place le FPH, par l’intermédiaire de la circulaire d’incitation à leur mise en œuvre adressée aux préfets, le 25 avril 2000. Cette généralisation est intervenue à la suite de plusieurs expérimentations menées dans le Nord-Pas-De-Calais.
En 2016, le Conseil national des villes (CNV) publie un avis sur le FPH. Cet avis souligne l’intérêt majeur du FPH comme outil de participation des habitants, tout en relevant les difficultés auxquelles il fait face dans sa mise en œuvre au sein des territoires. En effet, en 2016, d’après une enquête menée par le CGET, 40% des quartiers prioritaires n’étaient pas couverts par un FPH, révélant ainsi les fortes disparités relatives à la mobilisation et à l’utilisation du FPH entre les territoires. 10% seulement des FPH fonctionnaient avec une structure associative dédiée.
Cet avis du CNV dresse ainsi plusieurs constats :
- Une méconnaissance du FPH par les professionnels de la politique de la ville (techniciens des collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat, élus, associations) et par les habitants ;
- Une insuffisance de visibilité du dispositif par ces mêmes personnes, y compris par les publics qui en bénéficient.
- Dans les territoires où le FPH est mis en œuvre, la fréquence d’animation du dispositif est parfois faible.
Pour autant, selon l’avis du CNV, les FPH mobilisés permettent incontestablement de faire vivre des actions d’animation de quartiers grâce au soutien financier du fonds.
Face à ces constats, le CNV apporte quelques préconisations :
- Dissocier strictement la gestion financière (structure gestionnaire et porteuse du fonds) du comité d’attribution ;
- Etablir une charte de fonctionnement et un règlement intérieur spécifiant la composition des deux instances (comité d’attribution, comité de pilotage) ;
- Intégrer annuellement des habitants porteurs de projets l’année précédente aux jurys d’attribution pour favoriser la transparence dans la sélection des projets ;
- Communiquer et faire connaître le fonds en rendant public certains éléments afin d’améliorer la transparence du dispositif ;
- Rendre plus rapide l’octroi des fonds dès l’acceptation du projet par le comité d’attribution ;
- Diversifier les sources de financement du fonds ;
- Donner ou redonner au dispositif sa dimension initiale d’éducation citoyenne et émancipatrice par les projets soutenus en cadrant davantage son utilisation.